Mon histoire personnelle
Il fut un temps où les émotions intenses de ma fille prenaient beaucoup de place dans notre vie. Face à ces moments de débordement, j’avais l’impression que tout ce que je savais, tout mon travail personnel, s’envolait. Mon propre système nerveux se retrouvait complètement pris en otage, et c’était impossible d’accéder aux outils que je connaissais si bien. La mère forte et stable que je voulais être pour mon enfant disparaissait. Certains jours, j’arrivais à poser des limites claires et à co-réguler calmement ; d’autres jours, ma propre peur et mon anxiété prenaient le dessus, et ça ne faisait qu’empirer les choses pour nous deux.
Les déclencheurs de ma propre enfance :
Je me sentais dépassée et désemparée. Je pouvais guider d’autres parents, mais pour cette période, je ne pouvais pas m’offrir la même chose à moi-même. La culpabilité était très présente, car j’ai été élevée avec l’idée que j’étais responsable des sentiments des autres. Je comprenais la voie que je devais suivre, mais cette clarté ne venait souvent qu’après la tempête. Je me sentais incapable, seule, effrayée et le cœur brisé.
Pourquoi ?
J’ai grandi dans une maison où l’agression n’était pas permise—non seulement le comportement, mais aussi le sentiment lui-même. L’agression passive était courante, et exprimer les émotions ouvertement était dangereux. En grandissant, je n’ai jamais appris à considérer les émotions agressives comme normales ou sûres, ni à les réguler ou les comprendre.
Cela signifie que lorsque ma fille exprimait de l’agression, mon corps réagissait comme s’il était en danger. Ma petite-fille intérieure refaisait surface, et toutes mes blessures d’enfance non résolues demandaient à être vues et guéries. Dans ces moments, on a tendance à confondre nos propres émotions avec celles des autres. C’est comme le jeu de la patate chaude.
Être un parent réactif :
Face aux émotions intenses de mon enfant, il m’arrivait de réagir au lieu d’être présente. Mes déclencheurs et mes vieilles blessures prenaient le contrôle. Comme la petite fille que j’étais, j’étais terrifiée à l’idée que mon enfant se sente abandonné ou blessé si elle « perdait le lien » avec moi.
Alors, à quoi ressemblait ma réactivité ? Je me précipitais pour renouer le lien trop tôt. Ma peur de la blesser, comme mes parents m’avaient blessée, m’empêchait de la laisser expérimenter et réguler ses grandes émotions en toute sécurité.
J’ai réalisé qu’en me précipitant, je lui enseignais que son agressivité me faisait peur et je la rendais effrayée de ses propres sentiments. Sans le vouloir, je lui volais des occasions de développer sa régulation émotionnelle et sa résilience, des compétences que je voulais qu’elle cultive.
Briser le cycle :
Je pensais que ce serait plus facile de briser ce cycle. Après tout, j’avais suivi une psychothérapie personnelle pendant plus d’une décennie, j’étais une coach parentale certifiée, et j’avais les connaissances. Mais j’avais tort…
Être la première à briser un cycle générationnel est désordonné, non linéaire et prend du temps.
Le changement ne vient pas comme par magie ; il vient avec des efforts, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. J’ai dû prendre conscience de ma réactivité, m’observer avec honnêteté, ressentir ce qui devait l’être et travailler de manière intentionnelle sur mes propres déclencheurs.
Je me suis permis d’apprendre que la connexion ne se perd pas au moment où les choses deviennent difficiles, et que la réparation est plus puissante lorsqu’elle vient du calme plutôt que de la peur. Les moments de déconnexion ne sont pas dangereux, tant que l’on revient à la connexion une fois que l’on est prêt. Les enfants ne peuvent pas apprendre à tolérer leurs sentiments si nous ne les tolérons pas d’abord en étant avec eux dans le moment.
La parentalité réactive ne se manifeste pas seulement par des punitions ou des cris ; elle peut aussi venir de la peur, de la culpabilité ou d’une tentative excessive de réparation.

Qu'est-ce que la parentalité réactive ?
Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre à crier sur votre enfant, pour le regretter l’instant d’après ? Avez-vous parfois l’impression de réagir en mode pilote automatique, emporté par le chaos du moment ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul(e). C’est ce que l’on appelle la parentalité réactive.
Elle se produit lorsque nous répondons au comportement de nos enfants dans le feu de l’action, souvent par une réaction rapide, émotionnelle et impulsive.
C’est la parentalité en « mode survie », où nous sommes déclenchés et agissons sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement.
Cela peut se manifester par :
- Crier ou donner une punition sous le coup de la colère.
- Recourir aux menaces par frustration.
- S’excuser excessivement ou se précipiter pour réparer par culpabilité.
- Se figer ou se retirer pour éviter un conflit.
Ce genre de réaction n’est pas intentionnel ; il est le résultat du stress et de l’épuisement. Notre système nerveux se sent menacé, et nous réagissons automatiquement au lieu d’agir de manière intentionnelle.

Exemple : Mon enfant refuse de mettre ses chaussures
La réponse parentale réactive
Vous êtes devant la porte et votre enfant refuse de mettre ses chaussures, et vous êtes déjà en retard. Vous le dites une fois !… puis deux… le stress monte rapidement.
Vous craquez et vous criez :
» Mets tes chaussures MAINTENANT ! Pourquoi es-tu toujours si lent(e) ? Tu n’écoutes jamais ! Si tu ne mets pas tes chaussures tout de suite, on ne sort pas et il n’y aura pas de dessert après le déjeuner ! «
Ce qui se passe pour votre enfant :
- Stress et activation du système nerveux :
L’amygdale de l’enfant détecte une menace (les cris, la pression, la peur de perdre le lien) et déclenche les réactions de lutte, de fuite ou de figement. (Harvard Center on the Developing Child) - Débordement émotionnel :
Au lieu de se concentrer sur le fait de mettre ses chaussures, le cerveau de l’enfant est submergé par de fortes émotions : peur, frustration, honte ou résistance. - Apprentissage par la peur :
L’enfant peut commencer à associer les erreurs ou les retards à la colère et à la déconnexion du parent. - Boucle de lutte de pouvoir : Sa résistance augmente parce que son système nerveux est en mode survie, et non en mode raisonnement.
Ce qui se passe pour le parent :
- Stress et prise d’otage du système nerveux :
Votre amygdale est déclenchée par une » menace » perçue (la pression d’être en retard, le manque de coopération de l’enfant) et déclenche votre réaction de lutte ou de fuite. Votre cortex préfrontal—la partie responsable du raisonnement, de l’empathie et de la réflexion—est temporairement hors ligne. - Escalade émotionnelle :
Vous sentez la frustration, la panique ou la colère monter. Votre rythme cardiaque s’accélère, votre respiration peut devenir superficielle et votre voix peut s’élever. - Rétrécissement cognitif :
Dans le feu de l’action, votre concentration se réduit à la tâche urgente (sortir de la maison), ce qui rend plus difficile de voir la perspective de votre enfant ou de réagir calmement. - Culpabilité et regret après coup :
Après l’interaction, votre esprit réfléchi revient, et vous réalisez que vous avez réagi d’une manière qui ne correspond pas à vos valeurs parentales. Cela peut créer l’autocritique, l’anxiété ou un sentiment d’incompétence.Renforcement du cycle :
Votre état émotionnel exacerbé reproduit un comportement dicté par le stress, ce qui peut renforcer l’activation du système nerveux de votre enfant dans des moments futurs.

Qu'est-ce que la parentalité responsive ?
C’est tout le contraire. C’est une approche intentionnelle, régulée et empathique.
Cela signifie prendre une pause avant de décider comment réagir, en vous donnant un instant pour réfléchir à ce que votre enfant exprime réellement à travers son comportement. Il s’agit d’être présent, de comprendre leurs émotions et leurs besoins (les vôtres aussi !), et de choisir une réponse qui soit utile et constructive, plutôt qu’une simple réaction.
Cela peut prendre la forme de :
- Faire une pause pour respirer avant de réagir.
- Nommer l’émotion : » Je vois que tu es en colère « ou » Je vois que quelque chose te tracasse « .
- Exercer une autorité calme avec compassion.
- Réparer après une rupture en étant centré(e).
La parentalité responsive ne signifie pas la parentalité permissive. Cela ne veut pas dire que les enfants n’ont jamais de limites. Au lieu de cela, les enfants apprennent que toutes les émotions sont sûres à ressentir et que leurs parents les accueilleront avec assurance, et non avec peur.
Exemple : Mon enfant refuse de mettre ses chaussures
La réponse parentale responsive
Vous remarquez que votre enfant refuse de mettre ses chaussures et vous reconnaissez que vous ressentez le stress d’être en retard.
Vous faites une pause, respirez et vous vous rappelez :
» Les accidents et les retards font partie de l’apprentissage, et mon enfant est encore en train de développer ses fonctions exécutives et sa conscience spatiale. «
Vous dites calmement :
» On dirait que mettre tes chaussures est compliqué en ce moment. Prenons un instant. Apporte les chaussures, je vais t’aider… puis nous pourrons partir ensemble. «
Vous le guidez sans pression, l’intégrez au processus, et après qu’il ait participé, vous le remerciez et, si cela est pertinent, vous résolvez le problème ensemble : » Que pourrions-nous faire la prochaine fois pour que ce soit plus facile ? » Votre enfant peut répondre : » Je peux mettre les deux chaussures en premier, puis mon manteau. «
Vous reconnaissez : » Ça a l’air d’être un excellent plan ! «
» Sans pression « ne signifie pas que vous avez un temps illimité ou que votre propre stress disparaît comme par magie. Cela signifie que vous ne transférez pas directement votre sentiment d’urgence et de panique sur votre enfant. Au lieu d’utiliser votre stress pour forcer son obéissance, vous reconnaissez vos propres sentiments et agissez comme une présence régulée.
Ce qui se passe pour votre enfant :
- Sécurité et régulation du système nerveux :
Votre présence calme aide l’amygdale de l’enfant à se réguler à la baisse, lui permettant d’engager son cortex préfrontal. - Apprentissage par la co-régulation :
Il(elle) fait l’expérience d’un accompagnement sans menace, apprenant la résolution de problèmes et la patience. - Validation émotionnelle :
Se sentir vu et compris réduit la honte ou la frustration. - Développement des compétences :
Il(elle) s’exerce à la coopération, à l’autorégulation et à la prise de décision dans un environnement de soutien.
Ce qui se passe pour le parent :
- Cortex préfrontal activé :
En faisant une pause et en vous régulant, vous restez connecté(e) à vos centres de raisonnement et d’empathie. - Maintien d’une présence calme : Votre rythme cardiaque et votre respiration se stabilisent, réduisant les réactions impulsives.
- Modélisation de la régulation :
Votre enfant observe des stratégies d’adaptation et de régulation saines en temps réel. - Confiance renforcée : Le choix d’être présent(e) plutôt que réactif(ve) renforce votre identité parentale et votre résilience pour les moments futurs.
Les fondements neuroscientifiques
Quand les parents sont stressés, l’amygdale (le centre d’alarme du cerveau) peut prendre en otage le cortex préfrontal—la partie responsable de l’empathie, de la réflexion et de la prise de décision éclairée. C’est ce qui explique pourquoi la parentalité réactive prend souvent le dessus dans le feu de l’action, même pour des parents bien informés et aimants.(Harvard Center on the Developing Child)
La Théorie Polyvagale (Stephen Porges) ajoute une autre dimension : quand nous nous sentons en sécurité, notre système nerveux soutient la connexion et l’apprentissage. Quand nous nous sentons menacés, nous basculons en mode lutte, fuite ou figement, exactement ce que les enfants perçoivent chez nous.


Pourquoi la parentalité responsive est difficile (et les idées reçues)
Être un parent responsive n’est pas toujours facile. En fait, cela peut être incroyablement difficile, surtout lorsque vous êtes fatigué(e), stressé(e) ou que vous fonctionnez ‘à vide’.
Cela vous demande de gérer vos propres émotions en premier, ce qui est souvent la partie la plus difficile. Vous pouvez avoir l’impression d’échouer, ou qu’il est impossible de » faire les choses parfaitement » tout le temps. Mais rappelez-vous que l’objectif n’est pas la perfection, mais le progrès.
Même en ayant la connaissance, de nombreux parents ont des difficultés.
- Idée reçue n°1 : » Être responsive = être permissif. «
La réalité : Les parents responsives posent des limites, mais ils le font sans peur. - Idée reçue n°2 : » Si je reste calme, mon enfant le sera aussi. «
La réalité : Le calme aide, mais les enfants ressentent toujours toute la gamme de leurs émotions. - Idée reçue n°3 : » La connaissance seule suffit. «
La réalité : Dans le feu de l’action, de vieux déclencheurs prennent souvent le dessus sur ce que nous » savons « . Être responsive est une pratique, pas un trait de personnalité. - Idée reçue n°4 : » Mes parents m’ont crié dessus/m’ont puni, et je ne suis pas mort(e) : j’ai survécu. «
La réalité : Survivre n’est pas la même chose que s’épanouir. Oui, beaucoup d’entre nous ont » survécu » à une éducation stricte, mais souvent au prix de blessures cachées : des difficultés à faire confiance, la peur des conflits ou des problèmes d’estime de soi.
La parentalité responsive ne vise pas à ce que les enfants soient » à l’aise « . Il s’agit de leur donner les outils pour réguler leurs émotions, construire leur résilience et se sentir en sécurité dans leurs relations.
L'art de la pause
L’outil le plus essentiel pour passer de la parentalité réactive à la parentalité responsive est la » pause « . C’est une idée simple, mais cela peut tout changer.
Quand vous sentez que vous êtes sur le point de réagir, prenez un instant pour faire une pause. Prenez une grande respiration. Cette petite interruption vous donne la chance de calmer votre propre système nerveux et de choisir une réponse plus réfléchie.
Les étapes pour devenir plus responsive
- Reconnaître vos propres émotions :
Quand le comportement de votre enfant vous déclenche, reconnaissez vos propres émotions. Dites-vous : » Je me sens frustré(e) en ce moment « , sans aucun jugement (c’est la clé !). - Prendre un » moment Maman/Papa » :
Dites calmement à votre enfant : » J’ai besoin d’un instant pour y réfléchir, et je reviens dans deux minutes « , puis éloignez-vous pendant ces deux minutes. - Choisir votre réponse :
Une fois que vous êtes calmé(e), vous pouvez choisir une réponse qui est à la fois ferme et respectueuse. Un moyen utile d’y parvenir est de vous mettre à la hauteur de votre enfant, d’établir un contact visuel et de parler d’une voix calme. - Accepter l’imperfection :
Rappelez-vous qu’aucun parent n’est parfait. L’objectif est simplement d’être plus responsive que réactif(ve). Il s’agit de construire une meilleure habitude avec le temps.
Avancer sur ce chemin
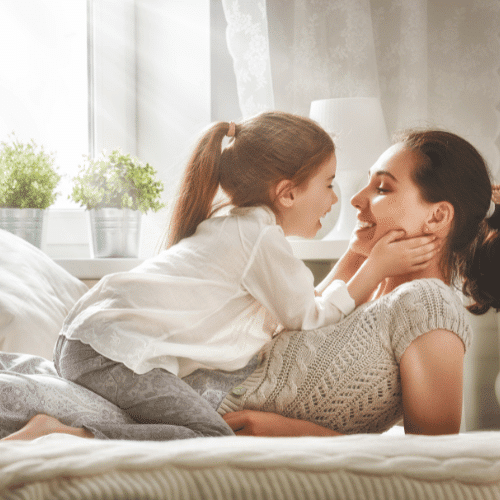
Si vous y avez été, ou si vous y êtes, vous n’êtes pas seul(e). C’est un chemin que beaucoup d’entre nous suivent de manière imparfaite, mais intentionnelle. La prise de conscience et la pratique sont déjà des pas vers le changement.
La parentalité responsive, par opposition à la parentalité réactive, n’est pas une question de perfection. Il s’agit d’être présent(e) plus souvent, de permettre la réparation quand elle est nécessaire et de briser les cycles, un pas à la fois.
